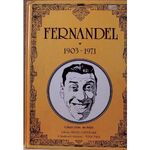-
Gustave Flaubert naît à Rouen en 1821. Son enfance s’y déroule dans le cadre austère de l’Hôtel-Dieu dont son père est médecin-chef et chirurgien. Gustave Flaubert fréquente ensuite le lycée local où il accomplit des études brillantes. Il se tourne déjà vers une carrière littéraire, composant des récits fantastiques imprégnés d’une exaltation encore toute romantique. Les grands thèmes que l’écrivain développera dans sa maturité sont déjà présents dans ces œuvres de jeunesse. A 16 ans, il s’éprend d’Elisa Schlésinger, une femme mariée, son aînée de quinze ans; il nourrit pour elle une passion qui inspirera plusieurs de ses œuvres. Après le baccalauréat, Flaubert entreprend à Paris des études de droit qui ne l’enthousiasment guère. Une maladie nerveuse le contraint à se retirer dans la propriété familiale de Croisset, sur les bords de la Seine, qu’il ne quittera plus qu’à l’occasion de quelques voyages. Après la perte de son père et de sa sœur, il y vit en compagnie de sa mère et d’une nièce orpheline. Dans cette retraite normande, Flaubert se consacre avec méthode et acharnement au métier d’écrivain; il peint la réalité avec une exactitude méticuleuse, en s’appuyant sur une documentation colossale. Au retour d’un voyage en Egypte, il passe plus de quatre ans à composer Madame Bovary. Il prête à son héroïne quelques traits de la poétesse Louise Colet avec laquelle il a noué un liaison orageuse. Le roman paraît dans la Revue de Paris en 1856; il vaut à l’auteur de comparaître devant un tribunal en raison du réalisme de certaines scènes. Finalement, Flaubert est acquitté; son procès l’a rendu célèbre. Il visite la Tunisie où il recueille les éléments de Salammbô, «étude antique» publiée en 1862. Après sept années d’un travail acharné paraît L’Education sentimentale qui ne rencontre pas le succès escompté. L’écrivain en conçoit une certaine amertume. La dernière période de sa vie est assombrie par la perte de sa mère et de ses meilleurs amis: le poète Bouilhet, Sainte-Beuve, Goncourt et George Sand avec laquelle il entretenait une correspondance suivie. Il récrit cependant une œuvre de jeunesse qui prend finalement le nom de Tentation de saint Antoine; il publie aussi ses Trois Contes (1877). La mort le surprend pendant la rédaction de Bouvard et Pécuchet qui reste inachevé. Flaubert, fortement marqué par la culture positiviste, s’est vite dégagé des outrances romantiques de sa jeunesse. Par un exceptionnel effort de volonté, il a discipliné son tempérament fougueux pour acquérir le réalisme et l’objectivité convenant à sa vision scientifique de la vie, qu’il appelle «le coup d’œil médical»; il s’est donné des règles esthétiques rigoureuses, recherchant la perfection formelle dans un style extrêmement châtié. C’est pourquoi, malgré les longues années de labeur qu’il a consacrées à son art, il a laissé une œuvre assez mince.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Romantiques contre classiques
En 1827, dans la préface de son drame Cromwell, Victor Hugo lance un véritable manifeste pour un renouvellement de l’art dramatique; il prétend «mettre le marteau dans les théories, les poétiques et les systèmes». Réagissant contre l’esthétique classique, il préconise le mélange des genres, l’abandon des unités, la recherche de la couleur locale. Ces théories, qui l’ont imposé comme chef de file de la jeune école romantique, il les a mises en pratique dans son drame Hernani, qu’on joue pour la première fois au Théâtre-Français en cette soirée du 25 février 1830. Les romantiques sont venus en force pour imposer l’œuvre de leur chef de file, cible d’une cabale montée par les partisans du classicisme. Scandalisés par les libertés que prennent les romantiques à l’égard des conventions et jaloux de succès qu’ils jugent illégitimes, les «classiques» ne peuvent admettre qu'Hernani puisse triompher sur la scène du Théâtre-Français — la future Comédie-Française —, l’une de leurs principales citadelles. Les romantiques forment une claque qui s’installe au parterre et aux secondes galeries dès 2 heures de l’après-midi. L’attente est longue dans la pénombre qui règne encore dans la salle. Lorsque le public entre dans la salle, il découvre avec stupeur, et non sans appréhension, une petite troupe haute en couleur de barbus et de chevelus revêtus de costumes extravagants. Théophile Gautier arbore à cette occasion un gilet d’un rouge incendiaire. Dans L’Histoire du romantisme, il décrira ainsi cette soirée mémorable: «Une rumeur d’orage grondait sourdement dans la salle, il était temps que la toile se levât; on en serait peut-être venu aux mains avant la pièce, tant l’animosité était grande de part et d’autre.» Dès les premiers vers, c’est le tumulte, les classiques protestant contre des hardiesses qu’ils jugent monstrueuses. Les romantiques répliquent. La confusion est indescriptible; on échange même des horions; mais les «perruques» reculent. Dès le IVe acte, les loges elles-mêmes applaudissent: c’est un indéniable succès pour les romantiques. L’éditeur Marne est séduit; il achète la pièce à Victor Hugo avant la fin du spectacle. Cependant, le lendemain, l’accueil réservé à Hernani par la presse n’est guère encourageant. Le drame est éreinté par la plupart des critiques. Certains crient au scandale, d’autres au fou. On s’inquiète de la faiblesse d’un gouvernement qui autorise de telles représentations. Les classiques ne désarment pas. Chaque soir, les partisans de Victor Hugo tentent de faire taire les sifflets, rires et quolibets, qui troublent la représentation. Toutefois, la conception romantique de l’art dramatique est parvenue à s’exprimer: «Le romantisme, déclare Victor Hugo dans sa préface d'Hernani, n’est, à tout prendre, que le libéralisme en littérature.»
 votre commentaire
votre commentaire
-
Le sauvetage du patrimoine national
Jusqu’au XIXe siècle, on se soucie peu de préserver les témoignages des époques précédentes. Les monuments civils et religieux de PAncien Régime ont subi les outrages du temps et les effets de la fureur révolutionnaire. Châteaux et églises se délabrent lorsqu’ils ont échappé au pic des démolisseurs. Alarmée par les dévastations révolutionnaires, la Convention a voté en 1794 une loi de sauvegarde des édifices publics, mais celle-ci n’a guère été appliquée et ce n’est que sous la Restauration que change l’état d’esprit à l’égard des vestiges du passé. Héritée de la Révolution, la conception du patrimoine national mûrit. Les romantiques remettent à l’honneur l’époque médiévale, longtemps considérée comme barbare, et s’inquiètent des dommages que subissent ses monuments: «Il faut qu’un cri universel appelle enfin la nouvelle France au secours de l’ancienne. Tous les genres de profanation, de dégradation et de ruine, menacent à la fois le peu qui nous reste de ces admirables monuments auxquels s’attachent la mémoire des rois et la tradition du peuple», s’indigne Victor Hugo. «Il faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays. Une loi suffirait; qu’on la fasse», poursuit-il. Une action réelle est entreprise sous la monarchie de Juillet. Louis-Philippe veut réconcilier la France avec son passé; il se veut l’héritier de la Révolution comme de PAncien Régime. L’entrée au gouvernement d’historiens tels que Guizot est décisive. Le 23 octobre 1830, le ministre de l’intérieur crée le poste d’inspecteur général des monuments historiques, attribué à Vitet, auquel succédera Prosper Mérimée. L’inspecteur est chargé d’établir un inventaire des monuments et d’étudier les moyens d’assurer leur conservation. En 1835, Guizot crée le «Comité des monuments inédits de la littérature, de la philosophie, des sciences et des arts considérés dans leurs rapports avec l’histoire générale de la France»; Hugo, Vitet et Mérimée y participent. La Commission des monuments historiques naît en 1837. Elle classe tous les édifices présentant un intérêt suffisant pour être placés sous la protection du gouvernement et statue sur les subventions à accorder. Le budget dont elle dispose décuple de 1831 à 1848. Grâce à la diligence de Mérimée, il permet le sauvetage et la restauration d’innombrables monuments parmi lesquels les églises de Saint-Savin, Poitiers, Vézelay, Notre-Dame, la maison de Jacques Cœur et les remparts d’Avignon. On a reproché à la Commission de s’être livrée à des restaurations excessives ou d’avoir reconstitué arbitrairement. Aujourd’hui, on se contente de dégager et d’entretenir. En 1952, on comptait 11 500 monuments classés.
 votre commentaire
votre commentaire
-
En 1971, quelques mois après Bourvil (1970), meurt l’un des monstres sacrés du cinéma français et l’un des plus grands comiques de notre temps: Fernandel. Fernand Contandin naît à Marseille le 8 mai 1903. Il donne son premier tour de chant à 5 ans. Il a 18 ans lorsqu’il devient comique troupier. Il fait aussi de l’opérette: Ignace, Le Rosier de Mme Husson, etc. Il aborde le cinéma en 1930, en même temps que Raimu. Son premier film est un muet de Marc Allégret, d’après une pièce de Guitry, Le Blanc et le Noir. Le triomphe vient très tôt avec une adaptation cinématographique du Rosier de Mme Husson (1932). Ensuite, c’est Angèle (1934), avec Orane Demazis. C’est aussi la première œuvre de Marcel Pagnol, dont la collaboration avec Fer- nandel donne au cinéma français quelques-uns de ses chefs-d’œuvre: Regain (1937), Le Schpountz (1938), La Fille du puisatier (1940), Nais (1945), Topaze (1950). Le public est sensible à la couleur locale, à l’accent du Midi, nouveauté à l’époque, à l’apparente naïveté de l’acteur. Les films de Fernandel sont très nombreux. Signalons la série des Don Camillo (à partir de 1951), où il donne la réplique à son frère ennemi, Gino Cervi (Peppone). D’autres titres encore contribuent au «mythe Fernandel»: François Ier (1936), qui raconte un rêve; Ignace (1937); Barnabe (1938), dont chacun a les refrains en tête; Simplet (1942), film-symbole où Fernandel est son propre metteur en scène; L’Auberge rouge (1951 );AliBaba (1955). Malheureusement, Fernandel n’évite pas toujours les effets faciles: mimiques stéréotypées, diction hyperthéâtrale. Mais il fait rire jusqu’à son dernier jour, que ce soit dans La Vache et le prisonnier (1959), Le Diable et les dix commandements (1962) ou La Cuisine au beurre (1964), où il a Bourvil comme partenaire. En 1964, il fonde avec Jean Gabin une compagnie cinématographique, la Gafer. En 1952, Rim demande à Fernandel comment il veut être défini. L’acteur répond: «Je m’en fous. (Dites) que je suis laid, vindicatif et prétentieux, que j’aime les cravates voyantes et les calembours... que je manque de goût, que j’ai horreur de la lecture, que je préfère Scotto à Beethoven, Dubout à Dau- mier... que j’ai un petit cerveau de bureaucrate dans un crâne de cheval...» Fernandel a occupé une place bien à lui dans le cinéma populaire; sans atteindre le niveau d’un Raimu ou d’un Gabin, ni même d’un Bourvil, il a incontestablement laissé son empreinte sur quarante ans de cinéma.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Les derniers feux de l’Ancien Régime
Vers 1720, une réaction se dessine contre la froide magnificence et le style surchargé et grandiose du siècle de Louis XIV. Dès la régence de Philippe d’Orléans, l’art s’adapte à une nouvelle mentalité, plus raffinée, et qui préfère le confort intime aux démonstrations de prestige. Les salons, si brillants au XVIIIe siècle, offrent un cadre accueillant pour les élites éprises des plaisirs de la conversation. Les boiseries sont sobrement compartimentées par une simple nervure moulée. Des bouquets de fleurs, des fruits, des feuillages, des palmes, des oiseaux, des singes et des chiens ornent lambris et rinceaux. Vers 1730, l’ornementation en vogue est la rocaille (rochers, grottes, coquillages). Les meubles sont légers et gracieux; les sièges, commodes, à la mesure du corps. L’ébènisterie triomphe: jamais les maîtres artisans n’ont montré plus de science et de goût du métier. Inspectés et protégés, ils sont tenus, par l’ordonnance du 12 décembre 1748, d’apposer leur marque sur les meubles de leur fabrication. Citons, parmi les plus célèbres, Gondreaux, Jean-François Œben, Gilles Joubert, Charles Crescent. Aux recettes éprouvées de la tradition, ils joignent les nouvelles curiosités mécaniques. Ils utilisent essences rares, bois des îles, marqueterie, vernis japonais, laques chinoises. Le Coromandel et les meubles peints s’accordent aux soieries claires pour ajouter à la gaieté des appartements. Les peintres Boucher, Nattier, et leur école, inspirent les décors. Ils emploient des couleurs pastel pour illustrer des sujets légers et galants, des pastorales aux allusions mythologiques qu’on peint au-dessus des portes et des glaces. L’exotisme est également à la mode: tur- queries, chinoiseries, singeries, couvrent les trumeaux. Après la découverte d’Herculanum .et de Pompéi en 1760, le rappel des formes droites gréco- romaines tempère les spirales fleuries. L’architecture du XVIIIe siècle reste, quant au fond, classique ou néoclassique; elle se signale par des angles adoucis, l’emploi du plein cintre au- dessus des baies, de grands cartouches de rocaille au-dessus des portails d’entrée. Sous le règne de Louis XV se construisent les grandes places royales: à Bordeaux, la place de la Bourse par Gabriel; à Paris, la place Louis-XV, future place de la Concorde, par Jacques-Ange Gabriel, le fils du précédent; à Nancy, la place Stanislas, par Héré. Le Petit Trianon, édifié à Versailles par Gabriel de 1763 à 1768, est un chef-d’œuvre d’ordonnance et d’élégance. On en retrouve les qualités dans les riches demeures des financiers et des grands seigneurs qui, au début du règne de Louis XV, ont abandonné Versailles pour Paris et le faubourg Saint- Germain.
 votre commentaire
votre commentaire