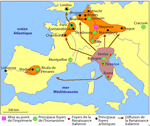-
Par nomeren le 12 Février 2015 à 11:51
Une marée montante
L’extension du protestantisme en France a été rapide et impressionnante, tant en surface qu’en profondeur. Telle est la constatation que peut faire l’historien qui considère la période qui suit la mort de François Ier (1547) jusqu’en 1562 environ. Il existe des groupes réformés dans toutes les provinces de France et dans toutes les classes sociales: on peut dire, alors, qu’un cinquième des habitants, peut-être davantage, est détaché de l’Eglise romaine.
Une carte de la France protestante opposerait en gros Test et le nord du pays aux régions de l’Ouest et du Midi. Dans le Nord, en Picardie, peu de chose, mais dans la région de Paris, avant les exclusions officielles, des groupes importants, Meaux restant un centre de dissidence religieuse.
Dans le Nord-Ouest, des progrès importants en Normandie et dans le duché d’Alençon. L’Eglise de Rouen regroupe près de 2000 personnes; à Caen, l’université est érasmienne et très libre de pensée. Dans le Maine, au Mans, il en est de même. La Bretagne est entamée par ses ports, comme Saint-Malo, du fait des échanges avec l’Angleterre et les Flandres, ainsi que Dieppe et Nantes. Vitré est un centre important. En 1559, une communauté se fonde à Rennes. Dans les régions de la Loire, la Tourai- ne et l’Orléanais avec leurs universités, le Berry avec Bourges, sont des centres actifs.
Dans l’Est, on note un moindre succès, sauf en Champagne. La Lorraine indépendante forme un bastion catholique mais, dans le Sud-Est, Lyon, ville de commerce, de banque et d’imprimerie, est au premier plan, de même que Valence. Le Massif central et l’Auvergne sont moins atteints, mis à part le Sud avec le Vivarais, et surtout le Languedoc avec Montpellier. Le Midi est ainsi gagné, de même que l’Ouest avec La Rochelle.
Au total, dira Coligny à la reine mère, 2150 Eglises ou communautés, comprenant une stratification sociale très étendue. A la base, les petites gens (petits bourgeois, petits commerçants, artisans, «gens mécaniques», laboureurs) auxquels s’est joint un petit nombre de personnes instruites (écrivains, théologiens, imprimeurs). Après 1559 se profile un double mouvement sociologique: l’entrée des notables dans l’Eglise, une partie des officiers royaux, des gens de robe, du monde des offices d’une part, et, d’autre part, l’entrée des gentilshommes qui vont trouver des chefs dans les familles qui touchent de près à la personne royale. Ils domineront l’Eglise jusqu’à la Saint-Barthélemy. Après cette date, on assistera à un nouveau phénomène: l’apparition en pleine lumière de la démocratie calviniste, guidée par ses ministres, qui prendra pied dans les villes et dans les bourgs plus encore que dans les campagnes.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par nomeren le 5 Janvier 2015 à 22:13
Après Marignan (1515), le pape Léon X décide de rencontrer le roi de France à Bologne en vue d’harmoniser les pouvoirs temporel et spirituel. Le 11 décembre, l’entrevue a lieu, ouverte par un discours en latin du chancelier Duprat. Les pourparlers continuent à Rome l’année suivante. La bulle du concordat est signée par le pape en août 1516 et approuvée par le concile du Latran en décembre. En avril 1517, François Ier en reçoit le texte définitif. Une distinction est établie entre bénéfices électifs et bénéfices collatifs.
Pour les bénéfices électifs — archevêchés, évêchés, abbayes, prieurés —, le roi a le droit de nomination; le pape, celui d’institution canonique; le droit d’élection des chapitres et des moines est supprimé. On fixe pour les nominations des conditions d’âges et de savoir: 27 ans pour un évêché, 23 ans pour une abbaye; une licence ou un doctorat en philosophie ou en théologie. La commande (cas d’une abbaye confiée au gouvernement d’un séculier) est en principe supprimée, sauf quelques exemptions en faveur de membres de la famille royale ou de personnes dites «sublimes».
Pour les bénéfices collatifs — conférés par les collateurs, seigneur local, chapitre —, on reprend les dispositions de la pragmatique sanction de Bourges: cures et prébendes restent à la disposition des collateurs, un tiers devant être réservé aux gradués des universités; le pape renonce aux «grâces expectatives», mais conserve le privilège du mandat apostolique qui lui permet de désigner une partie des sièges collatifs. Les appels à Rome sont conservés.
Le concordat renforce les pouvoirs du roi qui récupère ceux qui sont enlevés au pape. En revanche, les libertés garanties à PEglise de France par la pragmatique sanction sont amenuisées. Désormais, le monarque a la haute main sur l’Eglise de France, notamment sur les bénéfices électifs, les plus importants; il peut y placer ses familiers et ses favoris.
Mais les résistances ne tardent pas; elles viennent de trois côtés. Le 24 juillet 1517, le parlement de Paris refuse d’enregistrer le concordat. D adresse au roi des remontrances écrites auxquelles Duprat répond par un long mémoire. Les magistrats ne se soumettent que sous la menace le 22 mars 1518. Puis l’université proteste, s’allie au chapitre de Paris et organise des processions. Enfin, les états d’Orléans (1560), les conciles de Rouen (1581), de Reims et de Bordeaux (1583), demandent l’abolition de l’accord.
Ni le roi ni le pape ne cèdent: le clergé cesse d’être un corps pour devenir un ordre. Une aristocratie est créée dans l’Eglise qui devient un des rouages de la monarchie absolue.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par nomeren le 29 Avril 2014 à 08:00
«Pour instruire à la vraie piété»
L'Institution chrétienne paraît en mars 1536, à Bâle, chez Thomas Platter et Balthazar Lasius, en latin. C’est un petit in-octavo de 520 pages, auquel Calvin assigne un double but: donner aux fidèles, dont le nombre s’accroît, un traité de philosophie chrétienne qui distingue la doctrine protestante et en constitue l’armature; défendre les réformés en montrant la dignité de leur caractère et la légitimité de leur foi: leur croyance est celle de l’Ecriture; ils sont dans la vérité de l’Evangile. François Ier, auquel est dédié l’ouvrage, ne doit pas les persécuter mais les protéger, se rallier à eux dans le mystère de la vraie foi: tel est le sens de la préface du août 1535. L’ouvrage traite successivement du Décalogue, de la foi résumée dans le Symbole des Apôtres, de la prière, dont l’oraison dominicale fournit le type parfait, des sacrements du baptême et de la Sainte Cène. Sont étudiés, en plus, les «faux sacrements» que l’Eglise romaine a ajoutés aux deux primitifs. Le dernier chapitre s’occupe de la liberté chrétienne, du pouvoir ecclésiastique et de l’administration civile. L'Institution chrétienne révèle la double formation de son auteur: la systématique scolastique, qui prend la forme juridique d’une pensée tournée vers l’action; l’humanisme critique, qui remet en cause les institutions et pose le problème du pouvoir. Calvin affirme avec vigueur et détermination les deux principes fondamentaux de la Réforme: le Sola fide, poussé jusqu’à la prédestination; le Sola scriptura, qui fonde une Eglise visible bannissant toute imagerie religieuse et qui refuse la présence réelle. Au centre de l’Eglise demeure le Christ, dont le sacerdoce est annoncé dans PAncien Testament. A sa base prennent place la communauté des fidèles et les pasteurs qui servent le «troupeau» par la prédication et la prise en charge des sacrements. En liaison avec PEglise agit l’autorité politique, basée sur les devoirs du chrétien envers l’Etat; ces devoirs ne découlent pas de nécessités opportunistes mais d’une obligation purement religieuse. Le catéchisme de 1538, véritable quintessence de l’Institution chrétienne, reprend le problème des rapports de l’Eglise et de l’Etat, sujet non abordé par les catéchismes de Luther; on y trouve le trait le plus original de la pensée calviniste. En 1541, après le séjour du réformateur à Strasbourg, paraît l’édition française de l’Institution chrétienne. Le nombre des chapitres a passé de six à dix-sept; les éditions de 1559 et de 1560 compteront quatre livres; répandues largement en France, elles vont établir solidement la doctrine sans rien changer d’essentiel au texte de 1541, percutant et positif.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par nomeren le 29 Avril 2014 à 07:58
Des pierres où s'inscrit l'Histoire
L’histoire d’un pays s’écrit autant dans la pierre que dans les manuels: raconter les Tuileries, c’est raconter la France. Au XVIe siècle, au lieu dit «la Saisonnière», s’élevait une fabrique de tuiles qui donna son nom à la maison de campagne bâtie, sur son emplacement, par le sieur Neufville de Villeroi. A la mort d’Henri II, Catherine de Médicis installe la cour au Louvre. La proximité des «Tuileries» lui donne l’idée d’y faire construire, par Philibert Delorme, une maison de plaisance à l’italienne, entourée d’un parc. Le plan qui est en fait celui d’un gigantesque palais est loin d’être achevé à sa mort. Seuls sont élevés alors le pavillon central et les deux galeries adjacentes. Henri IV, peu après son entrée à Paris, entreprend la construction de la Grande Galerie et du pavillon de Flore qui réunissent le Louvre aux Tuileries. Le pavillon de Marsan, œuvre de Le Vau, voit le jour sous Louis XIV. Le Nôtre embellit le parc, crée la magnifique perspective centrale, creuse les bassins, aménage les parterres à la française. De 1789 à 1792, les Tuileries abritent Louis XVI et sa famille que les émeu- tiers parisiens sont allés chercher à Versailles en octobre 1789. 1792 est une année tragique pour le vieux palais: envahi une première fois le 20 juin, il est mis à sac au cours de la sanglante journée du 10-Août, qui voit le massacre de 600 gardes suisses. Rebaptisées Palais- National, les Tuileries sont occupées, en 1793, par la Convention, puis, en 1796, par le Conseil des Cinq-Cents. Une nouvelle vie de splendeur leur est insufflée par Napoléon qui crée la salle du Conseil, reconstruit le théâtre, fait élever l’arc de triomphe du Carrousel. A partir de PEmpire et'jusqu’à la fin du règne de Napoléon III, les Tuileries justifient leur vocation de résidence des souverains. Leurs vieux murs témoignent de toutes les convulsions qui agitent les institutions de la France: la chute de l’Empire, la Restauration et les Cent-Jours, les Trois Glorieuses et la monarchie de Juillet. Le 24 février 1848, de nouveau, les révolutionnaires envahissent les Tuileries. Le gouvernement provisoire émigre au Luxembourg puis à l’Hôtel de Ville. Le pouvoir réintègre le palais avec Napoléon III, à la suite du coup d’Etat du 2 décembre 1851. En 1871, les Tuileries paient un triste tribut à la Commune. Arrosées de goudron et de pétrole, elles sont incendiées par les insurgés. Ce qu’il en reste sera démoli sous la IIIe République. Seuls les pavillons de Flore et de Marsan seront reconstruits. Dans leur magnificence, les jardins demeurent un modèle de grâce et de goût, avec la grande allée qui, d’un élan triomphal, s’ouvre sur la perspective des Champs-Elysées.
 votre commentaire
votre commentaire
-
Par nomeren le 29 Avril 2014 à 07:57
La Renaissance du XVIe siècle se traduit non seulement par un retour aux sources antiques, mais aussi par un ample et profond renouvellement des mentalités; les élites saluent dans l’enthousiasme ce qu’elles croient être une aurore. De nos jours, on n’oppose plus formellement Renaissance et Moyen Age, comme le faisait Burckhardt. En effet, le génie du Quattrocento recèle des structures intellectuelles et morales qu’on retrouve en Italie, mais aussi en Flandre et en Allemagne du Sud où la civilisation a évolué dans le même sens. L’Italie n’a pas créé la Renaissance; elle a seulement illustré avec un bonheur particulier les aspirations artistiques, littéraires, juridiques et scientifiques de toute l’Europe. L’élan créateur de la Renaissance s’appuie sur deux progrès fondamentaux: l’invention et la diffusion de l’imprimerie, qui émancipe l’écriture et la pensée; les Grandes Découvertes, qui libèrent l’espace en élargissant le monde connu. S’y ajoutent les conditions socioculturelles du XVIe siècle naissant: la montée de la bourgeoisie, passionnée de savoir; le rôle du prince qui organise son Etat et qui, épris de gloire, joue au mécène; le déclin d’organisations traditionnelles comme le clergé et l’université; la solidarité raffermie des clercs et des artistes qui, rejetant les anciens cadres scolastiques, se groupent en académies et ouvrent au public l’univers de la forme, de la beauté et de la connaissance. La science prend un essor qu’on méconnaît trop souvent: l’anatomie, la physiologie, la chirurgie, les mathématiques progressent; en 1543, Copernic publie à Nuremberg son fameux traité, De revo- lutionibus orbium caelestium. En lettres, la philologie prend une place éminente avec l’édition et les commentaires des textes antiques, païens ou sacrés; Budé pour ceux-là, Erasme pour ceux-ci imposent leur autorité; l’étude du latin, du grec et de l’hébreu est pratiquée avec ardeur. Les sciences politiques approfondissent le droit romain et s’interrogent sur les problèmes posés par le pouvoir et l’extension du rôle social des fonctionnaires. En art, c’est l’Italie qui est le berceau des plus grands maîtres: Léonard de Vinci, le génie universel, Michel-Ange, le titan, Raphaël, le virtuose de la forme et de la beauté. A Florence, à Rome, bientôt à Venise, un art savant, dominé par la perspective, est à l’honneur; l’exemple est suivi au-delà des Alpes par Dürer à Nuremberg et par l’école de Fontainebleau en France. La Renaissance, c’est l’enthousiasme créateur sans doute, mais aussi la crise de conscience d’une élite qui vit intensément les conflits renouvelés de la foi et de la raison, de l’inspiration et de la règle, de la science et de l’ignorance, du cosmopolitisme et du nationalisme, de l’Antiquité et de la modernité, par-delà un Moyen Age qu’elle méconnaît et qu’elle rejette.
 votre commentaire
votre commentaire Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique
Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique